Veille juridique octobre 2019
 haque mois, notre juriste-conseiller réalise une veille juridique sur les modifications des lois impactant nos domaines de compétences (urbanisme, architecture, environnement, habitat, etc.).
haque mois, notre juriste-conseiller réalise une veille juridique sur les modifications des lois impactant nos domaines de compétences (urbanisme, architecture, environnement, habitat, etc.).
Le permis de régularisation emporte abrogation de l'arrêté interruptif de travaux
A la suite d'un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au Permis de Construire qui les autorise, un maire prend un arrêté ordonnant l'interruption des travaux à l'encontre du constructeur (Code l'urbanisme, art. L.480-2). Moins de deux mois plus tard, celui-ci obtient un Permis Modificatif régularisant au moins une partie des travaux en cause.
Dans ces circonstances, que devient l'arrêté interruptif ?
Cette question est tranchée par le Conseil d'État, statuant sur le rejet du référé-suspension que le constructeur avait engagé contre l'arrêt interruptif : l'intervention du PC modificatif a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux. En l'espèce, la demande de référé a donc été déclarée irrecevable car dépourvue d'objet. Cette abrogation implicite signifie, en pratique, que le constructeur à qui un permis de régularisation a été octroyé, peut reprendre ses travaux sans attendre la main levée de l'arrêté interruptif.
Une erreur sur l’affichage du permis de construire n'est pas toujours de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux
Le Conseil d’Etat a jugé que l’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette figurant sur le panneau d’affichage d’un Permis de Construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
Il souligne que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours seulement dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
Selon le Conseil d’Etat, la circonstance qu'une erreur sur le panneau d’affichage du PC puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est dépourvue d'incidence, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
En conclusion, le Conseil d’Etat juge que l'affichage d’un PC a pour objet de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet - mais pas de permettre, par lui-même, d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
En l’occurrence, la mention erronée de la superficie du terrain d’assiette n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
Les effets de l’annulation du PLU sur un projet de lotissement avant et après la loi Elan
Un maire a accordé à une société un Permis d’Aménager (PA) pour la création d’un lotissement, sur un terrain rendu constructible par le PLU. Mais le tribunal administratif a annulé la délibération approuvant ce PLU : le POS est donc redevenu applicable. Le problème, c’est que dans ce POS, le terrain en question n’est pas constructible.
Le juge rappelle que l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose : « Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement ».
Donc d’après cet article, dans ce délai de cinq ans, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement ne peuvent pas justifier un refus de permis de construire au sein de ce lotissement.
Mais le juge ajoute que cet article n’empêche pas un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.600-12 du même code, à cause d’une annulation contentieuse intervenue après l’autorisation du lotissement.
Pour information, la loi Elan du 23 novembre 2018, inapplicable en l’espèce, a ajouté à l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme un dernier alinéa selon lequel « l’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise ». Donc dans cette version de l’article, le projet de lotissement n’aurait pas été empêché.
Constructions illégales : la réparation du dommage n'implique pas forcément la destruction du bien
En l'espèce, M. W... G... a procédé, à compter de décembre 2014, à divers travaux sur un « caseddu » (ancienne bergerie) situé dans une zone classée Np (à protéger en raison de sa valeur paysagère) et Nz (à protéger en raison de sa valeur écologique, floristique et faunistique) au PLU de la commune, territoire sur lequel sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle. Précision importante : il ne s'agit pas d'une simple reconstruction ou remise en l'état du « caseddu », puisque l'intéressé reconnaît que « les murs étaient par terre », que la reconstruction n'est pas réalisée à l'identique et que la surface est passée de l'ordre de 38 m2 à 66 m2 selon la DDTM.
Un arrêté préfectoral ordonne alors l'interruption des travaux, mais le propriétaire passe outre. Convoqué devant le tribunal correctionnel, pour exécution de travaux non autorisés par un Permis de Construire et infraction au PLU, il est condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, le tribunal ordonnant également, sur l'action civile, la remise en état des lieux sous astreinte. Saisie par l'intéressé, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia, le condamne à 20 000 euros d'amende pour infractions au Code de l'urbanisme. Mais s'il condamne les infractions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia « énonce que le principe de la réparation intégrale du dommage n'impose pas aux juges d'ordonner la démolition que réclame la partie civile, mais de définir les modalités les plus appropriées à la réparation de celui-ci ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle considère notamment que « l'Office national des forêts n'a pas relevé de désaccord avec l'environnement, que la mairie qui ne s'est pas constituée partie civile, a indiqué que la restauration du caseddu se trouvait en totale corrélation avec la charte conclue pour la préservation du plateau et que le président de l'association pour la sauvegarde et l'avenir dudit plateau a confirmé cette déclaration en précisant que la construction s'intégrait parfaitement au site et ne nuisait en rien à l'environnement ».
Abandon de chantier en CCMI : que doit couvrir la garantie de livraison ?
Le garant de livraison doit prendre en charge les ouvrages indispensables à l'achèvement de la construction, même s'ils n'ont été mentionnés ni dans le marché ni dans la notice descriptive et que leur coût n'a pas été prévu.
Par un arrêt destiné à publication, la troisième chambre civile étoffe sa jurisprudence relative à l’étendue de la garantie de livraison. L’article L.231-6 du CCH oblige le garant de livraison à pallier la défaillance du CCMIste en cours de chantier. Sa garantie est, toutefois, limitée aux travaux initialement prévus par le CCMI. A ce titre, il n’a pas à payer des travaux optionnels qui ne lui auraient pas été communiqués par avenant ni à financer la levée des réserves pour des travaux non prévus au marché. Toutefois, l’article L.231-6, I, a, du CCH oblige le garant à prendre en charge les dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Il en résulte que la garantie de livraison doit couvrir tous les travaux non réalisés qui s’avèrent indispensables à l’achèvement de la construction, même s’ils ne figurent pas au CCMI. A l’appui de ce principe, la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel qui avait jugé que le garant n’avait pas à financer la réalisation d’une rampe d’accès au garage d’une maison individuelle, certes indispensable, mais non contractuellement prévue ni comprise dans le prix convenu.
De la validité des clauses de suspension du délai de livraison en VEFA
N'est pas abusive la clause qui prévoit qu'en cas de survenance d'une cause légitime justifiée par le vendeur, la livraison sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de la répercussion de cet évènement sur l'organisation générale du chantier.
En l’espèce, un contrat de VEFA avait prévu un délai de livraison au plus tard au cours du deuxième trimestre 2009. L’appartement et les deux boxes ayant été livrés le 26 janvier 2010, les acquéreurs avaient assigné le vendeur en indemnisation des préjudices résultant de ce retard, mais celui-ci leur avait opposé la clause suspensive du délai de livraison stipulée au contrat de vente.
Le vendeur avait été condamné par les juges d’appel qui avaient estimé que la clause en question constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite et donc nulle et de nul effet. En l’occurrence, cette clause, figurant dans le contrat sous le titre « causes légitimes de suspension du délai de livraison », stipulait qu’en cas de survenance des événements relatés, ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Les juges ont retenu que cette clause qui avait pour objet de doubler la durée des jours de retard non indemnisés par le vendeur, réduisait de façon importante l’indemnisation due aux acquéreurs, contredisant ainsi la portée de l’obligation essentielle du vendeur de livrer le bien acheté à la date convenue et créant, au détriment de l’acquéreur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
L’arrêt est cassé pour violation de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Contrairement aux juges d’appel, la Cour de cassation considère qu’une telle clause, prévue en cas de cause légitime justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maitre d’œuvre et fondée sur les répercussions de l’événement en cause sur l’organisation générale du chantier, n’a « ni pour objet, ni pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » et, partant, n’est pas abusive.

Trouvez un ouvrage, une revue, etc.
Avec notre moteur de recherche en ligne, trouvez le livre qui vous intéresse parmi plus de 1 700 références !
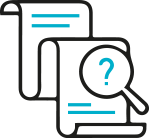
Des réponses à vos
questions !
Des questions sur les autorisations d’urbanisme, les contrats, les voisins, etc. Consultez nos fiches pratiques téléchargeables !

L’Observatoire CURIOSITE
La Gironde en un clin d'oeil. L'Observatoire CURIOSITE c'est une autre vision de l'architecture et du paysage girondin !